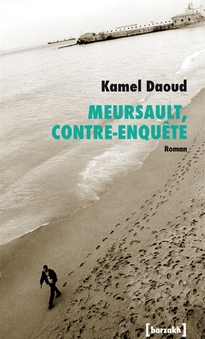(J’ai choisi cette couverture car c’est précisément l’édition algérienne de l’oeuvre que j’ai lue. Il semblerait qu’il y ait quelques différences significatives entre les éditions française (Actes Sud) et algérienne (Barzakh). Si des faits relatés ici ne se trouvent pas dans l’édition française, je vous saurais fort gré de m’en faire part ! )
Ce premier roman du journaliste algérien Kamel Daoud a bien failli être le lauréat du Prix Goncourt 2014, à une voix près face au roman Pas Pleurer de Lydie Salvayre. L’auteur est journaliste au Quotidien d’Oran et sa chronique polémique “Raïna Raïkoum” est la plus lue d’Algérie. Il est connu pour ses prises de position sans concession sur l’actualité de son pays, mais aussi sur l’actualité internationale. Il est également tristement célèbre depuis décembre dernier, lorsqu’un imam salafiste algérien, Abd El Fettah Hamdache, a lancé une fatwa contre lui, l’accusant d’être un “mécréant, apostat et sionisé […] qui insulte Dieu” et appelant le gouvernement algérien à le condamner à mort.
Bien qu’il s’agisse du premier roman de l’auteur, voilà une oeuvre magistrale et audacieuse. Ce roman, c’est l’histoire de Haroun, le frère de l’Arabe tué par Meursault dans L’Etranger d’Albert Camus. Cet Arabe, à qui il n’est même pas donné de prénom, a pourtant bien un nom, une famille, une histoire. Daoud donne au narrateur, Haroun, un droit de réponse à L’Etranger tout en adoptant la forme du long soliloque nocturne dans un bar caractéristique de La Chute, l’autre grand roman de Camus. C’est ainsi un formidable jeu de miroirs tendu sur l’ensemble de l’oeuvre de Camus que Kamel Daoud donne à lire.
Interrogé par un universitaire qui envisage d’écrire un livre sur l’oeuvre de Camus, Haroun, a décidé de réhabiliter son frère, l’Arabe, Moussa. De clamer son prénom, de lui rendre justice. Mais sa logorrhée est aussi l’occasion pour lui de laisser éclater la colère sourde qu’il a gardée en lui toutes ces années pendant lesquelles il a grandi dans l’ombre du frère défunt. Haroun raconte qu’il n’avait que sept ans lorsque Meursault a lâchement tué son frère, et que cet acte affreux a bouleversé sa vie. Il évoque le deuil éternel de sa mère, “M’ma” -avec qui il forme désormais un couple depuis que son père et Moussa sont morts-, la culpabilité d’être vivant et la difficulté de vivre avec le fantôme du frère absent et pourtant si présent. Le narrateur exprime l’amertume qu’il a gardée contre sa mère qui l’a maintenu toute sa vie dans un deuil morbide, absurde et étouffant :
Je te l’ai déjà dit, le corps de Moussa ne fut jamais retrouvé.
Ma mère, par conséquent, m’imposa un strict devoir de réincarnation. Elle me fit ainsi porter, dès que je fus un peu plus costaud, et même s’ils m’allaient trop grand, les habits du défunt -ses tricots de peau, ses chemises, ses chaussures-, et ce jusqu’à l’usure. Je ne devais pas m’éloigner d’elle, me promener seul, dormir dans des endroits inconnus ou, lorsque nous étions encore à Alger, m’aventurer au bord de la mer. La mer surtout. M’ma m’a appris à en craindre la trop douce aspiration -à tel point que, jusqu’à aujourd’hui, la sensation du sable se dérobant sous la plante des pieds, là où meurt la vague, reste associée pour moi à la noyade. M’ma, au fond, a voulu croire, et pour toujours, que c’étaient les flots qui avaient emporté le corps de son fil. Mon corps devint donc la trace du mort et je finis par obéir à cette injonction muette.
Il se souvient avec douleur et honte de sa vieille mère se traînant de rue en rue dans Alger, des jours entiers, à la recherche du coupable ou d’un membre de sa famille pour psalmodier les pires malédictions contre celui qui lui a enlevé son fils.
Haroun crache également son fiel contre Meursault qui n’a pas seulement tué Moussa mais aussi toute sa famille, la privant d’une dépouille et d’une tombe et jetant sur elle le voile noir d’un deuil sans fin. Il s’insurge contre le fait que Meursault ait été condamné par les “Roumis” (les Français) pour n’avoir pas pleuré la mort de sa mère plutôt que pour avoir tué son frère. Il lui en veut d’avoir élaboré de fausses excuses, telles que la chaleur et le soleil, pour justifier la mort de Moussa. Il l’accuse enfin d’avoir sali la mémoire de Moussa dans son livre : selon Haroun, Moussa n’a jamais été le proxénète que Meursault a décrit.
Tout le roman de Kamel Daoud est traversé par des réminiscences camusiennes. Entre le monologue inspiré de La Chute et les nombreuses références qui s’égrènent tout au long de l’oeuvre (le Mythe de Sisyphe par exemple), l’effet miroir avec L’Etranger est saisissant. Meursault n’est pas plus étranger que Haroun : ce sont deux étrangers devant faire face à l’absurde. Le narrateur n’est autre que le Doppelgänger du héros de Camus. Ainsi, le roman s’ouvre sur cette phrase qui entre en résonance directe avec celle de Camus : “Aujourd’hui, M’ma est encore vivante“, qui souligne le rapport à la mère par quoi tout commence. On reconnaît également une certaine symétrie entre Salamano qui hurle sans cesse sur son chien et le voisin du narrateur qui récite le Coran à tue-tête, ou lorsque le narrateur avoue détester les vendredis, de même que Meursault haïssait les dimanches. Haroun, comme Meursault, s’est rendu coupable d’un crime gratuit commis pour venger Moussa. Chacun met en évidence l’absurdité de la vie de l’autre. Ainsi, tout comme Meursault est condamné pour n’avoir pas pleuré la mort de sa mère, Haroun n’est pas condamné pour avoir tué un Français, mais pour n’avoir pas participé à la guerre de libération : aucun des deux protagonistes n’est véritablement jugé pour le meurtre qu’il a commis. Dans les deux romans, le meurtre introduit une césure dans le récit, le divisant en deux parties égales. Ainsi, le narrateur finit par incarner tous les reproches qu’il adresse à Meursault et sa haine devient identification. Il reconnaît ouvertement, par ailleurs, cette proximité avec le héros de Camus :
J’ai brièvement connu le génie de ton héros : déchirer la langue commune de tous les jours pour émerger dans l’envers du royaume, là où une langue plus bouleversante attend de raconter le monde autrement. C’est cela! Si ton héros raconte si bien l’assassinat de mon frère, c’est qu’il avait atteint le territoire d’une langue inconnue, plus puissante dans son étreinte, sans merci pour tailler la pierre des mots, nue comme la géométrie euclidienne. Je crois que c’est cela le grand style finalement, parler avec la précision austère que vous imposent les derniers instants de votre vie. Imagine un homme qui se meurt et les mots qu’il prononce. C’est le génie de ton héros : décrire le monde comme s’il mourrait à tout instant, comme s’il devait choisir les mots avec l’économie de sa respiration. C’est un ascète.
Derrière le récit et l’exercice de style, c’est également l’histoire de l’Algérie que Kamel Daoud revisite. La longue confession du narrateur permet de mettre en lumière un demi-siècle d’histoire algérienne. Depuis la mort de Moussa, Haroun a vécu la guerre de libération, l’indépendance et l’Algérie post-coloniale. Par ailleurs, ces références à l’histoire nationale dépassent le roman et laissent entrevoir l’auteur derrière le narrateur. Il y a, en effet, une confusion vertigineuse entre le(s) narrateur(s) et l'(es)auteur(s) : Haroun ne voit pas la différence et nomme le héros camusien “Albert Meursault”, ce qui laisse supposer -si l’on reste fidèle au jeu de miroir installé dès le début du roman- qu’une telle symétrie est envisageable entre Haroun et Daoud. Cela tient au fait qu’en Algérie, texte et auteur sont inéluctablement confondus autour de Camus. Ainsi, lorsque l’on connaît les chroniques de Kamel Daoud dans le Quotidien d’Oran ou pour Slate Afrique, on reconnaît quelques grands sujets chers à l’auteur et l’on ne peut être indifférent à la critique acerbe de Haroun de l’Algérie bigote où la religion prend trop de place et anesthésie le peuple, ainsi que de ce que l’Algérie nouvellement indépendante a fait de sa liberté :
La religion pour moi est un transport collectif que je ne prends pas. J’aime aller vers ce Dieu, à pied s’il le faut, mais pas en voyage organisé. Je déteste les vendredis depuis l’indépendance, je crois.
[…]
La foi, chez nous, flatte d’intimes paresses, autorise un spectaculaire laisser-aller chaque vendredi, comme si les hommes allaient vers Dieu tout chiffonnés, tout négligés. […] C’est l’heure de la prière que je déteste le plus -et ce depuis l’enfance, mais davantage encore depuis quelques années. La voix de l’imam qui vocifère à travers le haut-parleur, le tapis de prière roulé sous l’aisselle, les minarets tonitruants, la mosquée à l’architecture criarde et cette hâte hypocrite des fidèles vers l’eau et la mauvaise foi, les ablutions et la récitation.
[…]
J’ose te le dire, j’ai en horreur toutes les religions. Toutes! Car elles faussent le poids du monde. J’ai parfois envie de crever le mur qui me sépare de mon voisin, de le prendre par le cou et de lui hurler d’arrêter sa récitation de pleurnichard, d’assumer le monde, d’ouvrir les yeux sur sa propre force et sa dignité et d’arrêter de courir derrière un père qui a fugué vers le cieux et ne reviendra jamais. […]
Les gens me regardent curieusement parce qu’à mon âge je ne prie personne et ne tends la main à personne. Cela ne se fait pas d’être si proche de la mort sans se sentir proche de Dieu.
A travers le récit de Haroun, Kamel Daoud dresse également un constat lucide sur la situation de l’Algérie contemporaine, notamment sur son replacement dans un grand ensemble arabe au détriment de la nation contre lequel l’auteur s’est plusieurs fois insurgé dans ses chroniques. Ainsi, Haroun s’insurge à son tour : “On le désignait l’Arabe, même chez les Arabes. C’est une nationalité, “Arabe”, dis-moi?“. De même, Haroun compare la terre algérienne à une prostituée qui peine à se relever de la colonisation (“Si tu m’avais rencontré il y a des décennies, je t’aurais servi la version de la prostituée/terre algérienne et du colon qui en abuse par viols et violences répétées“) et raconte comment la guerre de libération a déchaîné la violence dans le pays : “la bête qui s’était nourrie de sept ans de guerre était devenue vorace. On tuait beaucoup“. “On en avait le droit puisqu’un roumi n’est pas un musulman“. Haroun témoigne avoir vu “se consumer l’enthousiasme de l’indépendance et échouer les illusions“ et remarque amèrement que les Arabes aujourd’hui “tournent en rond entre Allah et l’ennui“. Derrière les mots de Haroun, on devine Kamel Daoud se désolant que son pays n’ait pas su conquérir son identité.
Cette symétrie entre Meursault/Camus d’une part, et Haroun/Daoud d’autre part, est également frappante dans le choix de la langue française. Ici encore, on ne peut faire l’impasse sur ce que représente le français pour l’auteur. Kamel Daoud a appris le français en autodidacte dans une Algérie décolonisée qui a évincé cette langue de ses institutions et son histoire. Par conséquent, le choix du français est important et détonne dans ce contexte post-colonial. On se souvient des mots qu’avait eu Yacine Kateb au sujet de la langue française en Algérie dont il disait qu’elle était “un butin de guerre”. Kamel Daoud semble revenir sur cette affirmation lorsqu’il fait dire au narrateur que “les mots du meurtrier et ses expressions sont mon bien vacant“. Haroun apprend le français pour enquêter sur le meurtrier, non pas “pour pouvoir parler comme les autres, mais pour retrouver un assassin, sans me l’avouer au départ“. Dans le choix d’apprendre le français, il y a la volonté du narrateur de pouvoir informer M’ma sur le meurtre de son fils. Ironie de l’histoire, là où l’apprentissage de cette langue devait rapprocher ces deux êtres, la langue française finit par les séparer et permettre à Haroun de s’émanciper de sa mère. Singulièrement, Haroun se met à lire et relire L’Etranger qu’il a reçu de Meriem -une universitaire dont il est tombé amoureux- non plus pour glaner des indices, mais “pour y retrouver les traces de cette femme, sa façon de lire, ses intonations studieuses“. On le devine, Meursault, Contre-Enquête est un roman qui commence sur la haine de Haroun pour Meursault mais finit ailleurs.
Outre le choix symbolique du français, la langue est un pur délice. Kamel Daoud joue savamment avec l’alternance symbiotique entre style oral et écrit, entre les phrases qui crient la douleur et l’amertume de Haroun et celles qui mènent à la réflexion. L’écriture est majestueuse, juste et parfois poétique. De toute évidence, il faut avoir lu L’Etranger de Camus pour profiter pleinement du roman et en saisir toutes les subtilités et les richesses. Loin d’être un règlement de comptes littéraires, ce roman est tout à la fois un hommage et une réappropriation qu’il faut s’empresser de lire.